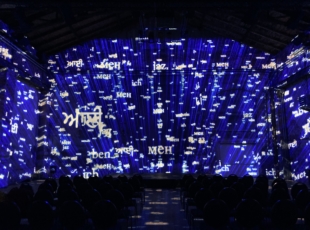Quand le jeu vidéo (sur)utilise la nostalgie

Auteurice de l’article :
Remake, reboot, retour de licences qu’on croyait disparues. Depuis quelques années, l’industrie du jeu vidéo recycle à tour de bras les titres qui ont fait sa gloire il y a plusieurs décennies. La raison de cette tendance : l’utilisation de la nostalgie par l’industrie vidéoludique. Un argument marketing puissant, mais qui a ses limites.
Tomb Raider est sorti il y a 28 ans, Final Fantasy 7 il y a 27 ans, Spyro le dragon, 26 ans. Vous le sentez, ce coup de vieux ? En réalité, le jeu vidéo a fêté il y a peu ses 50 bougies. Un sacré cap pour une industrie qui n’a eu de cesse de se développer, passant de passe-temps un peu honteux pour les “nerds” à phénomène de société très populaire (tant dans les cours de récré qu’au boulot) et plus rentable que le cinéma.
Cette longévité permet aujourd’hui au médium de posséder un vivier de joueur·euses extrêmement large. Il y a bien sûr les plus jeunes, qui découvrent leurs premiers jeux manettes en main et qui, pour les éditeurices et les studios, restent une cible privilégiée car assez facile à satisfaire.
Et puis, il y a un autre type de public tout aussi intéressant, voire encore bien plus pour l’industrie. Ce dernier, ce sont les joueur·euses expérimenté·es. Celleux qui ont déjà de (très) nombreuses heures derrière elleux. Celleux qui ont grandi avec les jeux vidéo.
Un public “fortuné” avide de nostalgie
Iels ont aujourd’hui entre 25 et 60 ans. Iels sont adultes et travaillent. Iels ont donc davantage les moyens de s’offrir des jeux. Mais ce n’est pas un public facile. Car en ayant eu l’occasion de se frotter à de nombreux titres différents, iels sont davantage critiques et difficiles à convaincre.
Face à cela, l’industrie a poursuivi pendant de nombreuses années la même tactique : tenter d’innover, de proposer des jeux aux concepts nouveaux, avec des graphismes toujours plus beaux, des mondes toujours plus grands, des scénarios toujours plus profonds. Le tout, développé par des équipes toujours plus grandes, composées parfois de plusieurs centaines d’employé·es.

Mais de ce fait, les échecs commerciaux sont devenus, financièrement parlant, beaucoup plus douloureux. Et en parallèle, ce public avidement visé par l’industrie est devenu de plus en plus difficile face à l’expansion de l’offre à sa disposition. Il fallait donc trouver une solution, et les éditeurices ont eu une idée géniale : jouer sur la nostalgie.
En reprenant des licences et des titres adulés par ces joueur·euses des années (voire des décennies) auparavant, iels sont parvenu·es à les toucher au cœur, à faire appel à des moments vécus, de bons souvenirs provenant de l’enfance ou de l’adolescence et intrinsèquement liés à des périodes heureuses de leur vie.
De quoi faire baisser la garde de ces joueur·euses réputé·es “difficiles”, capables de dépenser sans compter pour regoûter à leur madeleine de Proust.
Reboots et remakes en pagaille
Autre avantage de cette stratégie, la baisse des coûts. Pas besoin de reprendre tout depuis le début. Le matériel de base existant déjà, il suffit de l’adapter. Pour cela, trois techniques sont depuis plusieurs années largement utilisées par l’industrie du jeu vidéo.
La première, c’est le remake. La recette est simple. On prend un jeu vidéo qui a marqué sa génération il y a de cela plusieurs années. On réutilise à l’identique (ou pratiquement) son scénario, son gameplay (c’est-à-dire ses règles et la manière dont il se joue), et on adapte les graphismes et les menus avec les technologies d’aujourd’hui.
Gros avantage de cette technique : sa prise de risque très faible, puisqu’on utilise tel quel un matériel qui a fait ses preuves, et un coût de production ultra faible grâce aux peu de ressources en personnel nécessaires pour mener à bien un tel travail. Parmi les exemples marquants de ces dernières années, on peut citer The Legend of Zelda : Link’s Awakening, Spyro le Dragon, Crash Bandicoot N’Sane Trilogy, Dead Space ou encore Resident Evil (dans ce dernier cas, Capcom, l’éditeur et propriétaire de la franchise, a fait un remake de l’ensemble des jeux Resident Evil sortis).
Autre technique, un peu plus onéreuse celle-ci, le reboot. Pour cette dernière, le processus est un peu différent. Le but est de reprendre les éléments qui ont fait la force d’une licence et de proposer une toute nouvelle direction à cette dernière sous la forme d’un nouveau titre. Il ne s’agit donc pas d’une suite puisqu’elle vient plutôt “redémarrer” la licence (d’où le terme “reboot”). Parmi les exemples les plus marquants de cette méthode, il y a God of War, Tomb Raider, Doom, ou encore Ratchet & Clank.
Enfin, il y a les suites qui, contrairement aux reboots, s’inscrivent directement dans la continuité des précédents opus. L’exemple le plus réussi de ces dernières années, nous en avons déjà parlé longuement, c’est Baldur’s Gate 3, sorti 20 ans après son prédécesseur.
Les limites de la nostalgie
Mais ce recours sans cesse plus important à la nostalgie commence à montrer ses limites. D’une part parce que la ficelle, de plus en plus visible, a poussé les joueur·euses à devenir de plus en plus méfiant·es devant des œuvres qui n’étaient, pour certaines, que des pâles redites du jeu d’origine. D’autre part, parce que le sentiment de nostalgie lui-même a tendance à biaiser nos jugements. On a en effet le réflexe d’idéaliser des souvenirs du passé, en les mêlant à un contexte particulier. Cela rend les éléments qui en faisaient partie plus beaux et plus magiques qu’ils ne l’étaient réellement.
De ce fait, quand on remet la main sur un jeu vidéo de notre passé, on peut être déçu·e car on est incapable de revivre en y rejouant ce qu’on avait ressenti à l’époque. Cette déception, de nombreux joueur·euses ont pu en faire l’expérience avec la foule de remakes, reboots et suites mis sur le marché. Et iels sont à présent nettement plus frileux·ses à céder aux sirènes de la nostalgie.
Enfin, il y a l’incapacité pour les développeur·euses à reproduire l’originalité et la qualité d’un succès atteint des années plus tôt. Car ces réussites étaient aussi liées à un contexte particulier et sans lui, il est beaucoup plus difficile de parvenir à le reproduire.
Un exemple récent nous vient du studio belge Appeal et de son reboot de sa licence mythique nommée Outcast. Le jeu, sorti en 1999, avait marqué les esprits, convaincant non seulement la presse spécialisée mais également les joueur·euses de l’époque. Et cela, avant tout grâce à son système de rendu graphique utilisant la technologie voxel, un procédé novateur à l’époque qui offrait un résultat très détaillé même sur des ordinateurs peu puissants. Couplé à un scénario et un game design réussis, le jeu est resté dans la postérité comme l’une des pierres angulaires de l’industrie vidéoludique belge.
Or, au début de cette année, Appeal a tenté de faire renaître la flamme avec Outcast “The New Beginning”. L’idée : reprendre la mythologie du premier jeu, le même héros et le même univers, mais offrir aux joueur·euses une aventure en monde ouvert, avec une direction artistique et des graphismes dignes d’une grosse production et un gameplay complètement repensé.
Malheureusement, le jeu n’a pas réussi à convaincre. Selon la presse spécialisée, c’est son manque d’originalité, son scénario particulièrement plat, son monde ouvert très peu inspiré et ses lacunes de rythme qui sont à blâmer. Mais la raison principale de cet échec, c’est surtout son incapacité à reproduire la prouesse de son aîné, qui s’était détaché de ses concurrents grâce à l’originalité de son moteur graphique. Et sans cela, Outcast n’est qu’un jeu moyen, loin, très loin des souvenirs idéalisés des personnes qui, comme nous, l’avaient adoré en 1999.
Une histoire, des projets ou une idée à partager ?
Proposez votre contenu sur kingkong.
à découvrir aussi

Entre Belgique et Japon, les nouveaux territoires du numérique créatif

La Journée du Podcast à Namur : un porte-voix pour les métiers du son et leur professionnalisation

Stereopsia, cœur européen des technologies de l’immersion